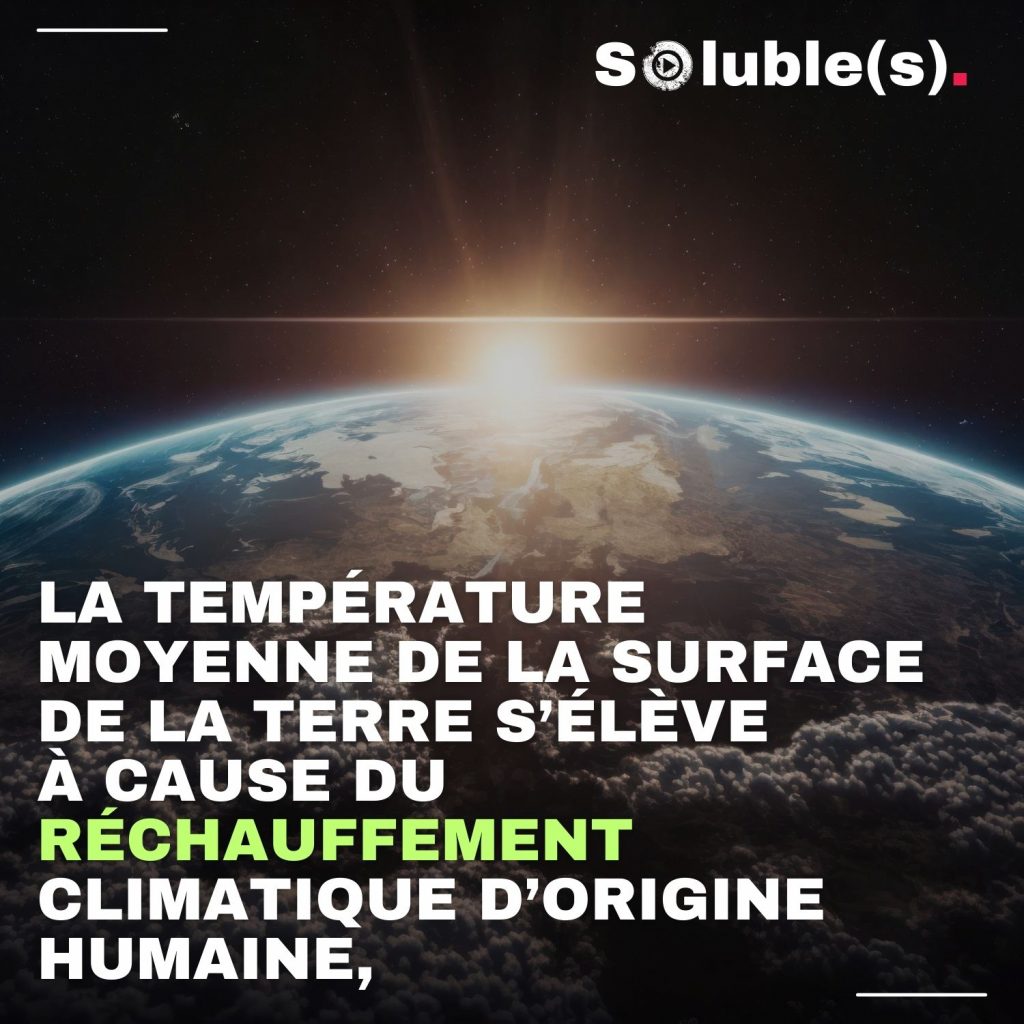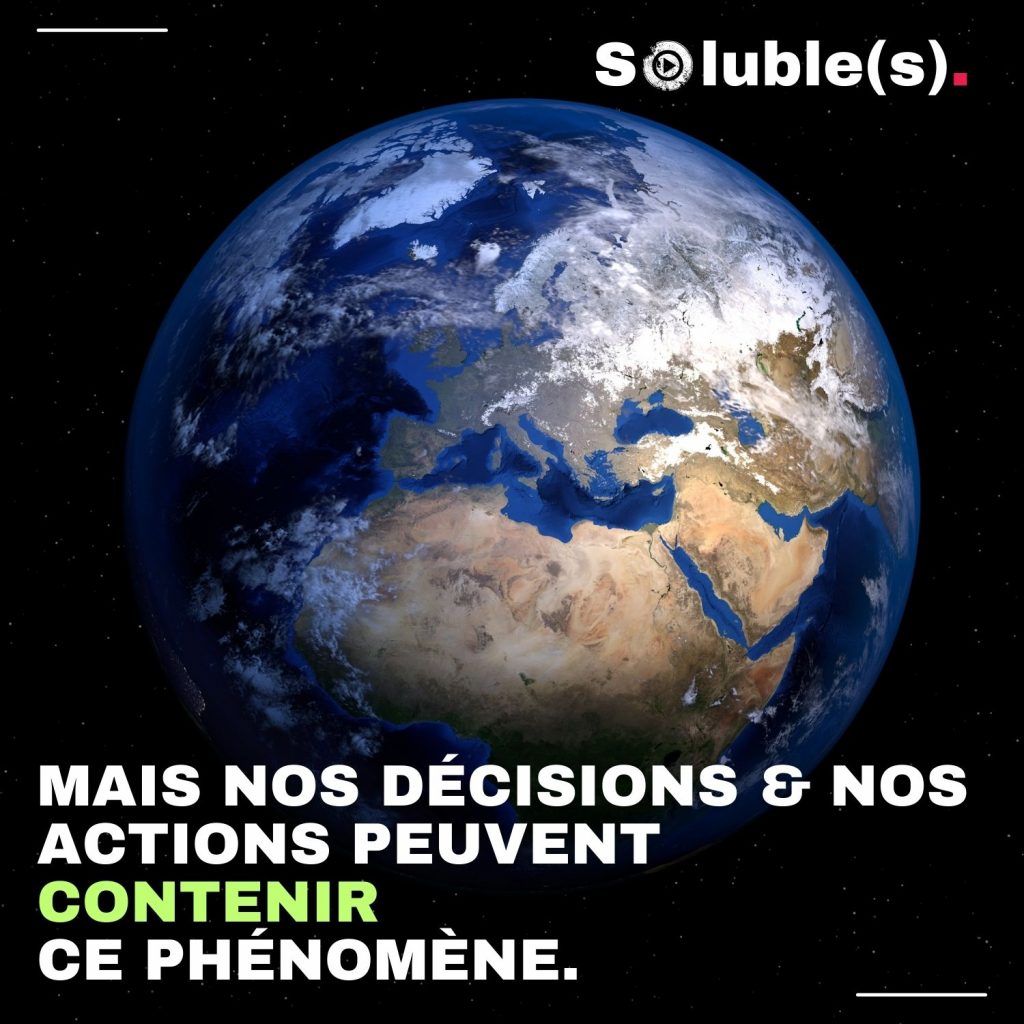Dans le sillage de l’urgence climatique, l’impératif d’adapter la France sans freiner la réduction des émissions s’est hissé au rang de nécessité incontournable. Mais comment s’y prendre ? Pour Soluble(s), Gonéri Le Cozannet, chercheur et co-auteur du sixième rapport du GIEC, décrypte les solutions d’adaptation au changement climatique que la France doit impérativement accélérer pour rester habitable d’ici 2100.
Transcription (Automatisée)
>> Lire l’article original : S’adapter à +4 °C en France : mode d’emploi – Avec Gonéri Le Cozannet
- Photo : Canva.
- Photo : Canva.
L’adaptation : un complément indispensable
– Simon Icard : Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble(s). Aujourd’hui, on se demande ce que ça signifie de s’adapter et d’adapter nos vies et nos sociétés à un monde dont le climat se réchauffe dangereusement à cause des activités humaines. Et vous allez l’entendre, des solutions sont à notre portée. Mais le temps file vite. Le temps s’accélère.
Bonjour Gonéri Le Cozannet.
– Gonéri Le Cozannet : Bonjour
Tu es un scientifique, un chercheur, l’un des auteurs du sixième rapport du GIEC, le GIEC. C’est une appellation que l’on commence à connaître. C’est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Un organe des Nations unies qui est chargé de l’évaluation objective de la recherche scientifique sur le changement climatique. Alors, le but est d’éclairer les États, de diffuser les connaissances pour que leurs décisions soient prises en bonne connaissance de cause, si l’on peut dire.
Tu es un spécialiste des questions d’adaptation et tu travailles sur l’impact de l’élévation du niveau des mers. Avec toi, on va chercher à comprendre pourquoi la France et de nombreux pays se sont d’ores et déjà engagés dans cette voie, celle de l’adaptation. On va, comme toujours, dans ce podcast, être très concrets. Tu nous diras ce que ça signifie pour nous. Où sont les zones de danger et sur quoi agir. Et évidemment, pourquoi est-ce nécessaire ?
Mais d’abord, on a envie d’en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, comment tu t’es retrouvé à t’intéresser à ces sujets-là ?
– Gonéri Le Cozannet : Alors moi, je travaille au BRGM, c’est le service géologique national depuis 2006. Et j’ai travaillé au début sur les questions d’élévation du niveau de la mer et d’impact en termes d’érosion et de submersion marine. Et assez rapidement, en fait, la question, c’est plus seulement d’évaluer les risques, mais c’est aussi de voir quelles sont les options pour s’adapter, c’est-à-dire réduire ces risques qui augmentent avec l’élévation du niveau de la mer. Et donc c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à travailler sur l’adaptation.
Alors voilà, tout en gardant ma spécialité qui est quand même plutôt au départ l’évaluation des risques. Et donc effectivement, c’est au cours de la rédaction du sixième rapport du GIEC que là, en fait, l’enjeu, c’était vraiment de mettre en avant les réponses d’adaptation pour que les États soient informés de quelles sont les options qui s’offrent à eux en termes de politiques publiques, en termes d’investissements pour réduire ces risques climatiques qui sont en augmentation rapide, l’augmentation des risques et les solutions à mettre en place.
– Simon Icard : Alors, nos auditrices et nos auditeurs sont conscients que le climat de la planète change. Mais pour bien comprendre la suite de cet épisode, peux-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi, alors que nous sommes en train de lutter contre le réchauffement climatique, il apparaît nécessaire de mener en parallèle cette autre course, celle de l’adaptation ?
– Gonéri Le Cozannet : Cela fait quand même au moins 25 ans que l’adaptation est un sujet important sur les politiques climatiques.
C’est-à-dire que le simple fait d’atténuer le réchauffement climatique ne suffira pas, parce qu’on a déjà aujourd’hui un réchauffement climatique de 1,3 °C au-dessus du niveau préindustriel qui a des impacts. On a une élévation du niveau de la mer qui est aujourd’hui de 4 millimètres par an, mais qui est en accélération. Et on sait qu’on dépassera 60 cm, un mètre, deux mètres au cours des prochaines décennies et siècles en fait. Et donc on sait qu’on a besoin d’adaptation.
Donc, je dirais, c’est quelque chose en fait. Peut-être qu’au début, effectivement, dans les années 2000, quand le concept était mal précisé, on pouvait avoir l’impression que l’adaptation était une démission sur les enjeux d’atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, c’est parfaitement compris comme étant en fait le complément indispensable d’une politique d’atténuation très forte visant à stabiliser le climat en deçà de deux degrés.
Un des sujets de recherche importants qu’on a, sur, dans la communauté scientifique, ce sont les limites à l’adaptation. On sait qu’on ne peut pas s’adapter à tout. Et on sait qu’on ne peut pas s’adapter en fait, au-delà d’un certain niveau de réchauffement. Alors ça dépend des secteurs. Mais par exemple, vous prenez les questions de l’eau.
Par exemple, dans le rapport du GIEC, on a des alertes sur un niveau de réchauffement supérieur à trois degrés global, c’est-à-dire quatre degrés. C’est le niveau de réchauffement qui est prévu par le troisième plan national d’adaptation au réchauffement climatique en France. Au-delà de ces trois degrés, on estime qu’il y a des limites d’adaptation qui seront atteintes. C’est-à-dire qu’on aura des sécheresses pluriannuelles qui font que les stratégies d’adaptation actuelles fondées sur le stockage ne fonctionneront plus. Et alors peut-être que ce sera au cours de trois années de sécheresse par exemple, qui se succéderont, qui pourraient ressembler à celle de 2022 par exemple.
Donc, si vous voulez, aujourd’hui, l’adaptation, c’est vraiment le complément de l’atténuation. À vrai dire, il y a un troisième sujet qui est important, c’est aussi, c’est aussi la question des pertes et dommages. En fait, si vous regardez l’Accord de Paris, il y a l’atténuation, l’adaptation, c’est l’article 7 et l’article 8, c’est les pertes et dommages. Et en fait, si je reprends un petit peu les termes d’un chercheur qui s’appelle Ben Orlov, en fait, on dit “on va éviter l’ingérable”. Ça, c’est l’atténuation.
“On va gérer l’inévitable”, ça, c’est l’adaptation.
Mais en fait, ça ne suffit pas parce qu’on sait qu’on va avoir des impacts et on sait qu’on a des impacts aujourd’hui, comme des feux de forêt avec des pertes irrémédiables. On sait que les coraux sont en train de subir les pertes de chaleur qui… On sait qu’il y a des gens qui meurent pendant les canicules. Donc tout ça, c’est des pertes et dommages irrémédiables.
Et la question, c’est comment on mutualise, comment on indemnise c’est ces pertes et dommages, en fait, comment les… Et c’est la raison pour laquelle c’est un troisième pilier, en fait, des politiques climatiques qui est moins bien connu que l’adaptation et qui va un petit peu à l’encontre de ce message un petit peu optimiste qui est qu’on va gérer l’inévitable et éviter l’ingérable. En fait, il y a aussi des impacts qu’on n’aura pas bien réussi à gérer en fait, et qu’on ne sait pas gérer aujourd’hui. Déjà, très vite, voir la vérité en face, les choses telles qu’elles sont, s’adapter, les gérer, mais aussi déplorer certaines conséquences et y faire face.
Les vulnérabilités face à la chaleur
– Alors, on va voir dans un instant que tu le disais déjà, que le changement climatique a des conséquences sur nos paysages, sur nos sols, sur nos côtes, donc sur les endroits où nous vivons et nous travaillons. Mais nous nous parlons fin août 2025, alors que la France venait de sortir de sa deuxième vague de chaleur de l’été.
Onze jours de chaleur écrasante sur la quasi-totalité du territoire métropolitain et la Corse. Qu’est-ce que cela illustre du point de vue de la nécessité de s’adapter ?
Où sont les vulnérabilités face à la chaleur qui rendent ces périodes de plus en plus difficiles à vivre ? Il faut le dire.
– Je dirais en fait, la première vulnérabilité, c’est que la politique d’adaptation par rapport à ces vagues de chaleur, elle est extrêmement réactive en fait, c’est-à-dire qu’on voit ça comme des crises, comme des crises exceptionnelles qu’il va falloir passer, et puis après on revient à la gestion antérieure. Alors que la réalité, c’est que tous les chercheurs du climat savent très bien que ces vagues de chaleur, elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes, et que cela va continuer à devenir de plus en plus fréquents, intenses et longs au fur et à mesure que le climat va se réchauffer.
Tant qu’on n’aura pas stabilisé le réchauffement climatique, ces vagues de chaleur continueront à s’aggraver.
Donc la question, ce serait plutôt en fait d’avoir une forme d’anticipation et de se dire que on a besoin d’un en fait, de rafraîchir, de se rafraîchir.
Se rafraîchir, c’est pas forcément la clim. La clim, en fait, c’est un outil qui est probablement indispensable dans beaucoup de cas, mais qu’il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie parce qu’il crée en fait des inégalités d’accès. En fait, il y a des gens qui ont accès à la clim, et ceux qui n’ont pas accès subissent le fait que l’air chaud va dans les rues.
Donc si vous voulez, en Europe, en France notamment, il n’y a pas beaucoup de clim aujourd’hui. Donc, on a ce qu’on appelle l’îlot de chaleur urbain qui est une aggravation de la, pendant la vague de chaleur, dans la zone urbaine car il n’y a pas assez de végétation, parce qu’il y a les bâtiments qui… Enfin, il y a des matériaux qui stockent la chaleur, qui la restituent pendant la nuit, etc.
En fait, l’enjeu, c’est d’atténuer cet îlot de chaleur urbain et atténuer cet îlot de chaleur urbain. C’est vraiment pour. En fait, ça nécessite des travaux sur l’urbanisme et notamment, en fait, tous les travaux de végétalisation qu’on voit dans les villes.
Ça vise à atténuer cet îlot de chaleur urbain, entre autres, en fait. Mais, mais c’est très efficace. L’enjeu pour les villes françaises, c’est qu’aujourd’hui il y a peu de clim qui est développée, c’est de développer en fait des îlots de fraîcheur de telle manière que les besoins en climatisation soit suffisamment faible pour que dans dix, quinze, vingt ans, on ne se retrouve pas avec des villes qui aient trois ou quatre degrés, enfin, disons deux ou trois degrés de plus d’îlots de chaleur urbains parce qu’on aura développé massivement la clim.
Quand vous regardez le rapport du GIEC, on a vraiment cette inquiétude sur les inégalités, en fait. Voilà.
Maladaptation : le complément de l’atténuation
– Simon Icard : Oui, parce que tout le monde ne pourra pas, évidemment, tout le monde ne pourrait pas s’équiper massivement de clim. D’ailleurs, ça me fait rebondir sur le sujet, la définition de la maladaptation. Là, tu évoques la climatisation, est-ce que c’est, ce que tu disais est un exemple de maladaptation et surtout au-delà de la clim, qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on évalue une bonne et une mauvaise solution d’adaptation ?
– Gonéri Le Cozannet : C’est… L’évaluation du succès de l’adaptation est très difficile. C’est-à-dire que sur l’atténuation, on sait très bien le succès. Le verdict, c’est les émissions de gaz à effet de serre sur l’adaptation. En fait, c’est plus compliqué.
Alors, il y a un cadre global qui est en train de se constituer où, en fait, on met bien en avant qu’une adaptation doit comprendre un certain nombre de domaines thématiques les infrastructures, les écosystèmes, la transition juste, etc. S’ils ne font pas tout ça, effectivement, il y a probablement des trous dans la raquette.
Il y a un enjeu de planification évaluer les risques, anticiper, planifier, mettre en œuvre, évaluer et puis recommencer ce cycle. Donc à nouveau, si on n’est pas très fort sur la mise en œuvre, c’est ce qui arrive aujourd’hui en Europe. Il y a probablement des manques. Et puis en fait, il y a toutes les conditions facilitantes, donc la gouvernance, les finances, etc. Donc tout ça, c’est ces conditions facilitantes. Aujourd’hui, le constat qu’on fait, c’est que elles ne sont pas là non plus. En fait, le rapport du Haut Conseil pour le climat alerte sur le manque de financement du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique. Donc, cette grille de lecture qui est en constitution au niveau international, notamment avec les COP, permet déjà de se faire une idée.
Où est-ce qu’on en est sur l’adaptation en France et en Europe ? Et on voit qu’on a quand même beaucoup à progresser et à renforcer en fait. Voilà maintenant la maladaptation, qu’est-ce que c’est, la maladaptation ? C’est finalement une action, avec ou non l’intention de ce de réduire les risques climatiques qui au bout d’un moment finit par les aggraver.
Alors, elle finit par les aggraver parce que par exemple, vous allez avoir des émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être le cas de la climatisation quand on n’a pas une électricité décarbonée. Elle peut les aggraver parce qu’elle va accroître des inégalités.
C’est le cas avec la climatisation, si elle est générée de manière massive. Mais une climatisation qui est bien utilisée pour protéger les personnes âgées dans des dans des pièces qui sont rafraîchies, une climatisation qui est utilisée dans des écoles pour protéger les enfants pendant les vagues de chaleur qui interviendront tôt ou tard en juin. Bon, ça, ça fait partie du panel de réponses, si vous voulez la maladaptation.
Moi ce que je dis là, c’est pas des travaux scientifiques, mais enfin, quand je fais un petit peu le bilan de toutes les choses, c’est difficile de dire ceci est de la maladaptation.
La clim n’est pas de la maladaptation par nature, elle est de la maladaptation si elle est développée de manière massive et anarchique, de la même manière que le stockage d’eau n’est pas de la maladaptation par nature, il est de la maladaptation.
Si en fait, il est développé de manière massive et que, en fait, on n’a plus d’eau pour les écosystèmes et qu’on crée des inégalités d’accès à l’eau, vous voyez.
– On comprend bien qu’il faut cette vue d’ensemble et le côté massif, le côté sociétal, mais aussi des adaptations face à des réalités locales ou individuelles.
– C’est ça. Il y a une ligne de crête, en fait, à bien conserver pour que, en fait, les solutions d’adaptation que l’on envisage, elles ne deviennent pas de la maladaptation parce qu’elles ont été développées de manière anarchique.
Les risques et les solutions en France
– Toute la société est concernée par la nécessité de s’adapter. Il est impossible de tout aborder dans un seul épisode. Mais tu le disais, la France, le gouvernement français a décidé de son plan national d’adaptation en préparant le pays à un scénario de plus quatre degrés, plus quatre degrés. C’est par rapport à l’époque préindustrielle, plus quatre degrés prévus en 2100.
Cela doit s’accélérer, même si 2100 paraît assez loin pour vu de notre quotidien.
On a parlé de la chaleur, mais où se situent les principales vulnérabilités de notre pays et sur lesquelles agir en priorité du point de vue de l’adaptation ?
– Alors, je dirais la base de départ de ce plan national d’adaptation, c’est une identification des risques clés qui peuvent affecter la France et l’Europe. Et cette identification des risques clés, elle est vraiment fondée sur le rapport du GIEC. Donc, elle est assez solide.
En fait, il y a quatre grands risques clés. Il y a les vagues de chaleur, leur impact sur les humains, les écosystèmes.
Il y a les pertes de productivité agricole avec les sécheresses, etc. Il y a également le.
En fait, les problèmes liés à la gestion de l’eau, en fait, qui affectent l’agriculture, mais pas uniquement.
Également l’accès à l’eau dans les villes, etc.
Et puis il y a tout ce qui est inondations qui peuvent être liées aux pluies intenses. Parce que le changement climatique, c’est une intensification des pluies intenses. On a plus d’eau dans l’atmosphère lorsqu’il pleut. En fait, c’est plus intense.
Et puis l’élévation du niveau de la mer avec les submersions marines.
Donc ça, c’est les risques clés.
Et derrière, il y a toute une série de risques en cascade, notamment les feux de forêt, etc.
Donc cette identification est relativement bien faite et les 52 mesures du Plan national d’adaptation, en fait, sont des mesures qui sont globalement assez consensuelles dans la société parce qu’il y a énormément, un gros travail de consultation pour ce plan, pour pour finalement, en fait, commencer à fournir des réponses.
L’évaluation qui est faite de cette, de ce plan d’adaptation, c’est que, aujourd’hui, il est. En fait, il ne constitue pas une réponse suffisamment forte face à des risques qui augmentent de manière très rapide, et notamment sur ce dont on parlait sur les îlots de chaleur urbains, en fait sur tout ce qui est canicule, qui est pas un risque à 2100, qui est un risque pour la santé, le risque pour l’été deux mille vingt-cinq, voilà, il s’est un peu matérialisé, mais finalement un peu comme attendu, l’été deux mille vingt-cinq est-ce qu’il est si surprenant dans un climat actuel qui est réchauffé de 1,3 degrés ?
Moi, ce que je comprends de mes collègues climatologues, c’est non. En fait, c’est un. C’était un été absolument impensable au vingtième siècle, mais aujourd’hui, c’est quelque chose qui est normal au niveau de réchauffement actuel et qui sera froid demain, en fait.
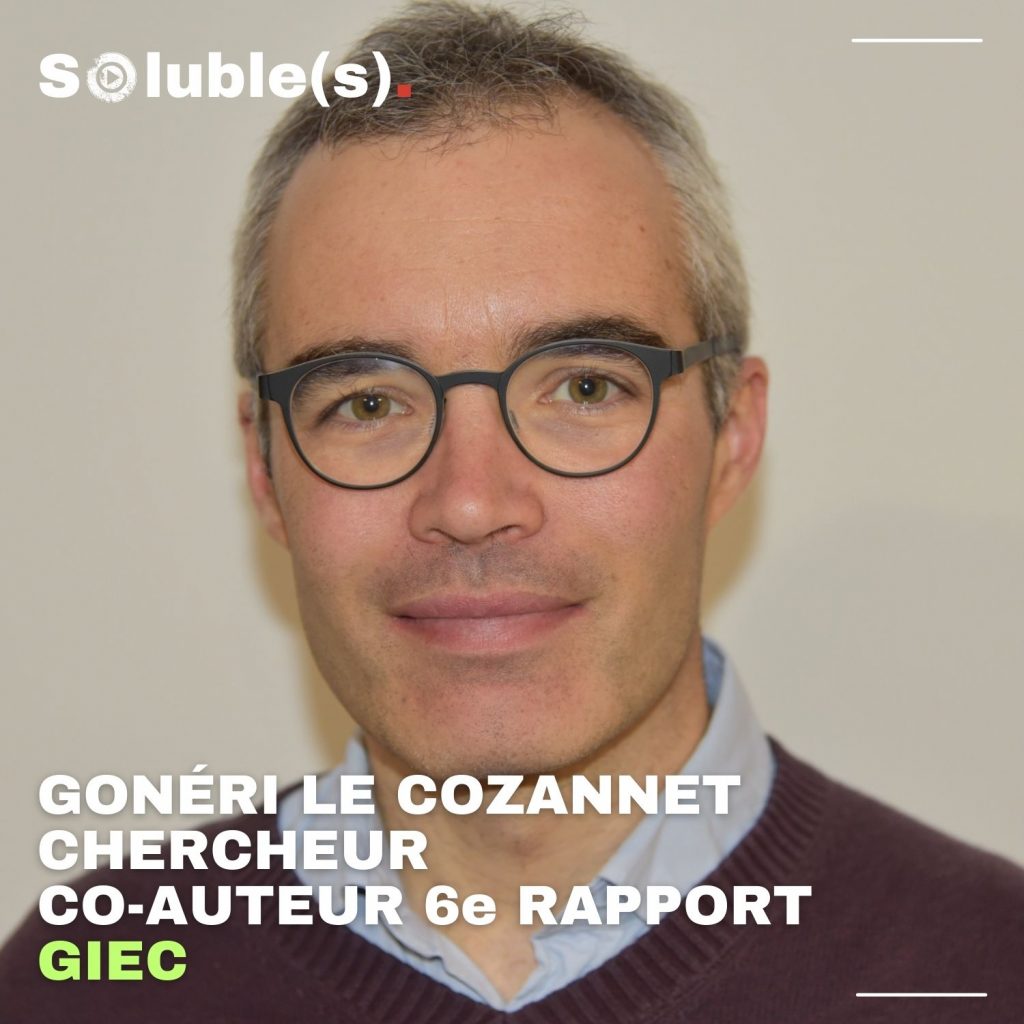
L’élévation du niveau de la mer et l’assurance
– S.I : Oui parce que Météo-France a différents scénarios de prévisions d’élévation des températures avec des risques à plus 50 degrés dans des vagues de chaleur en 2050.
– G.L-C : Exactement.
Donc là, en fait, si vous voulez, les questions, en fait de, de, qui se pose, en fait, ça va être au niveau des villes. Il y a des élections municipales en 2026, ça va être l’urbanisme, en fait, c’est quel projet d’urbanisme pour faire face à ces vagues de chaleur ? Et donc il y a à travailler sur les couleurs des bâtiments, les matériaux qu’on utilise. Mais ça, c’est difficile.
La végétalisation, c’est difficile aussi, mais il faut le faire. Donc là, on parle quand même de transformations qui sont assez massives. On n’est plus dans de l’adaptation incrémentale, on est dans ce qu’on appelle l’adaptation transformationnelle, et ça va, ne va pas se faire en fait, avec quelques mesures, on va dire incrémentales, qui vont viser à protéger quelques travailleurs pendant les. Il faut protéger les travailleurs, Mais là aussi, est-ce que les mesures sont suffisantes ?
À mon avis, non. Voilà.
Vous relisez les mesures qui concernent par exemple les fonctionnaires ou les travailleurs en extérieur. Bon, il y a des facilités pour travailler chez soi, mais est-ce que chez soi, on est protégé des vagues de chaleur ? Pas tout le monde. Moi, ce n’est pas mon cas par exemple.
– Donc l’évaluation des risques est bien faite, mais les réponses, les solutions sont à préciser et sans doute que la société doit mieux s’interroger collectivement. Alors, à la fois les décideurs publics, mais évidemment les citoyens.
Tu évoques les élections. On ne sait pas d’ailleurs si ce sujet sera majeur pendant les élections municipales, mais c’est un de ceux qui…
– Il devrait l’être, parce que là, on a six ans devant nous, et il faut bien voir que dans les six prochaines années, on va dépasser les un degré cinq, on va être à un degré six, un degré sept peut-être. Peut-être pas un degré sept, Mais on va dépasser le un degré cinq et en fait, on va avoir des épisodes climatiques majeurs. Aujourd’hui, vous vous ouvrez les journaux.
En fait, il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait une catastrophe climatique quelque part en Europe. En France donc, les pour, les pour les maires qui sont exposés à ces risques, je pense que ignorer ce sujet, ce serait vraiment une très, très grave erreur. En fait, c’était déjà le cas en 2020. D’ailleurs, en 2020, on sentait bien que la décennie qui était devant nous allait être une décennie d’augmentation très grave des risques climatiques.
Et c’est effectivement ce qui s’est passé. En fait, il y a eu, voilà, 2022, la sécheresse, les canicules, 2025, canicules 2022-2023-2024. On a eu des pluies intenses qui sont aussi cohérentes avec le réchauffement climatique. Donc vraiment des sujets en fait que tout le monde a intérêt à prendre au sérieux.
– Et ça signifie entre les lignes, ce que je comprends, que l’échelon territorial, l’échelon régional local est un bon échelon pour pour décider de la mise en œuvre de ces politiques ?
– Alors, je dirais, ce qui se passe, c’est que, en fait, idéalement, il y a une articulation efficace entre les différents niveaux de décision.
Et donc, au niveau national, le dispositif du plan national d’adaptation est quelque chose de très important et son existence est saluée. Maintenant, compte tenu des alors, des faiblesses qu’on a dans ce plan en termes de financement, en termes d’ambition, de certaines mesures pour des risques qui se matérialisent déjà en termes de protection des écosystèmes aussi, c’est quelque chose qui est. Voilà, en termes de prise en compte de la transition juste, c’est-à-dire est-ce que les plus vulnérables sont bien protégés dans ce plan d’adaptation, compte tenu de ces faiblesses sur ces sujets-là ?
Eh bien effectivement, il y a d’autant plus d’intérêt à ce que, au niveau local et au niveau régional, il y ait des politiques extrêmement fortes en fait. Donc, c’est pour ça que je. Oui, effectivement. Alors, même au niveau. Quand on parle de local, en fait, il faut bien voir qu’on a les régions qui sont, qui jouent un rôle extrêmement important dans la transition, voilà, elles sont ces fameux SRCAE, les, les schéma régional climat, air, énergie, etc. Mais, mais mais en fait, après, il y a les départements qui investissent, il y a les métropoles, les communes, etc. Donc en fait, l’articulation entre tous ces niveaux de décision est extrêmement important.
Il est très probable qu’on se retrouve avec des majorités qui soient différentes, et il faut bien que tout le monde se rende compte qu’il s’agit d’un sujet sur lequel tout le monde a intérêt à avancer. L’adaptation. L’adaptation, c’est réduire les risques. Donc en théorie, tout le monde a intérêt à réduire les risques, réduire les risques.
– Donc, on entendait l’évaluation des risques, la chaleur, l’agriculture, l’eau avec un manque d’eau et un trop-plein d’eau. Du point de vue des catastrophes, lorsqu’il y a des inondations et une surmortalité et un accroissement des inégalités.
Alors parlons de l’eau justement.
En France, 66 % du littoral est en recul, 1,4 million de logements sont menacés d’ici 2050. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l’archipel français au sud de l’île canadienne de Terre-Neuve. La mairie travaille déjà sur le déplacement du village vers l’intérieur. En Guadeloupe. 10 % de la population est exposée à des risques de submersion.
Pour la métropole, tu dis que les traits de côte vont changer dans les décennies à venir, mais à quoi s’attendre concrètement ?
– Je pense que le premier sujet d’inquiétude par rapport à l’élévation du niveau de la mer, c’est avant tout les submersions marines.
Aujourd’hui, si vous regardez les coûts, si vous regardez les risques pour les vies humaines, les submersions marines, il y a des problèmes d’érosion partout en France et d’ailleurs, c’est un sujet de préoccupation.
Il y a énormément de travaux parlementaires pour renforcer un petit peu la réponse publique à ces problèmes d’érosion.
Mais, si vous regardez vraiment, si vous vous intéressez à l’effet, c’est un problème qui existe déjà. En fait, si vous regardez l’effet de l’élévation du niveau de la mer, les submersions marines, c’est quelque chose, en fait sur lequel on s’attend à une augmentation assez drastique, en fait, des risques au cours des prochaines décennies.
L’érosion, c’est peut-être un peu plus tard. Schématiquement, sur le trait de côte sableux, ce qu’on dit, c’est que un mètre d’élévation du niveau de la mer, ça va être dix mètres de recul du trait de côte. Alors évidemment, pour le trait de côte sableux et puis ça va être très différent selon le contexte local, c’est, disons, une espèce de moyenne qui est basée sur des lois géométriques qui ont été constituées dans les années soixante.
Et aujourd’hui, on n’a pas forcément beaucoup mieux, en fait, pour évaluer ce type de risque. Voilà.
Donc, le recul du trait de côte est une chose, mais il y a la submersion marine et à très court terme, sur les prochaines décennies.
En fait, le risque, c’est que le prochain hiver, on a une submersion marine et que ça coûte un milliard d’euros et qu’il y ait une cinquantaine de morts, un peu comme “Xynthia” (tempête). Xynthia, c’était 750 millions d’euros de dommages assurés attribués à la submersion marine et une cinquantaine de morts.
– C’est la question que j’allais te poser. Quand on entend submersion marine, c’est sur des phénomènes ponctuels, pas sur un phénomène permanent ?
– C’est ça. C’est la submersion marine.
C’est en fait aujourd’hui, ce sont des tempêtes, pendant des tempêtes.
On a une surélévation du plan d’eau parce qu’on a une baisse des pressions, on a des vents, on a des vagues et puis on peut avoir des franchissements à la côte, on peut avoir un débordement au-dessus des eaux, au-dessus des dunes ou des défenses, et puis des zones habitées qui sont inondées. Voilà. Et après, l’évacuation de l’eau est plus ou moins lente selon la topographie, selon tout un tas de paramètres. Les.
À un moment, effectivement, on peut avoir la submersion permanente, mais là, on n’y est pas encore. L’élévation au niveau de la mer, il faut bien voir que c’est un processus qui est quand même assez. En fait, la réponse des glaciers de montagne, la réponse de l’océan, la réponse de l’Antarctique et du Groenland au réchauffement climatique, elle est assez lente. Elle est. Elle est lente. Elle se fait sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d’années.
Et donc en fait, là, si aujourd’hui, on stabilisait le réchauffement climatique, on aurait des centaines d’années en fait d’élévation du niveau de la mer devant nous. Et on sait déjà qu’à un degré cinq, on dépasse deux mètres, mais dans plusieurs centaines d’années. Et les deux mètres à quatre degrés de réchauffement climatique, ça peut être au vingt deuxième ou vingt troisième siècle. Et donc une prévision, il faut agir dès maintenant.
Les solutions fondées sur la nature
– 3,7 à 4 millimètres par an, parce que c’est ce que je comprends. Oui, mais si on additionne les années, évidemment, ça ne fait que monter.
– Oui, c’est ça en fait, le niveau de la mer.
Alors, il y a une variabilité qui est liée au fait que, selon la variabilité climatique, vous avez plus ou moins de précipitations, en fait, sur les continents ou sur les océans. Mais en fait, en réalité, quand on regarde la courbe, c’est vraiment une espèce de parabole, en fait, qui est en accélération depuis le vingtième siècle. Voilà, fin du vingtième siècle, c’est deux millimètres par an. Aujourd’hui, on a quatre millimètres par an. Et voilà, on va continuer à accélérer, en fait, sur le niveau de la mer.
Là, la question de l’anticipation, elle est vraiment fondamentale, parce que les mesures d’adaptation dont on parle, en gros, c’est soit de la protection côtière qui coûte extrêmement cher, soit des relocalisations qui coûtent cher aussi, qui sont difficiles à organiser. Donc ça nécessite une gouvernance très fine, mais qui apporte des bénéfices importants en termes de protection de la biodiversité, souvent. Et bien en fait, ces deux solutions d’adaptation à long terme qui sont les deux seules efficaces, eh bien en fait, on va avoir en fait, c’est.
Elles nécessitent beaucoup de temps à être mises en œuvre et nécessitent des dizaines d’années.
– De l’acceptation aussi, parce que, s’il faut reculer un village, on le voit évidemment les les habitants se posent des questions, même très pratiques sur l’immobilier, sur leurs conditions de vie, tout simplement.
– C’est ça.
Et c’est là que l’exemple de Miquelon est intéressante parce que, en fait, c’est un.
C’est un exemple sur lequel a travaillé Xénia Philippenko, en fait, qui est que, au départ, un plan de prévention des risques estime que finalement, à Miquelon, le village de Miquelon qui est sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, où il y a six cents habitants, le village de Miquelon, et bien si on applique les règles de plan de prévention des risques.
Rien n’est constructible parce que tout est exposé aux submersions marines.
Donc là, évidemment, les gens protestent. On comprend qu’ils soient un peu choqués par le résultat et rejettent en fait ce constat et rejettent les réponses qui sont apportées, qui sont de l’inconstructibilité. Et puis au bout d’un moment, se pose la question de dire, mais finalement, si on, au lieu de construire les nouveaux bâtiments sur la zone basse, on allait à quelques centaines de mètres plus loin, où on a une zone qui est quelques mètres au dessus du niveau de la mer. Est-ce que ça ne résoudrait pas le problème ?
Et là en fait, on a un retournement de situation où des gens qui finalement pensent long terme parce qu’ils investissent sur le territoire, en fait, c’est, c’est vraiment des gens qui, qui voilà qui, qui qui qui sont ancrés sur le territoire, qui entendent y rester très longtemps et bien se disent que dans leur intérêt, c’est peut-être plus d’organiser cette relocalisation avec le soutien de l’État.
Il y a un soutien de l’État, mais, mais du coup, on a eu un retournement de situation entre un rejet vers une adhésion et un projet qui devient le projet local de relocalisation. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas figées.
Ça veut dire qu’en fait il peut. Enfin, c’est un bon exemple qui montre que les gens ne sont pas forcément figés dans un rejet de plein de choses. On peut avoir des réponses qui sont des perceptions qui évoluent. Voilà. Et là du coup, c’est un projet qui qui commence en fait.
– Oui, les travaux sont en cours. On est en train de déplacer les réseaux d’électricité et d’eau, je crois.
– C’est en cours.
– Et donc sur un, sur un temps relativement long.
– C’est ça, ça va prendre des décennies, mais c’est le temps. Le temps approprié, en fait.
On n’a pas besoin d’aller plus vite. Donc donc, c’est. Donc, c’est un très bon exemple. Il y a un autre exemple de relocalisation en France, c’est tous les travaux qui sont menés par le Conservatoire du littoral. Alors là, c’est sur des zones qui sont plutôt peu urbanisées puisque le Conservatoire du littoral achète des terrains pour protéger, finalement les protéger de l’urbanisation. Mais du coup, ce sont des terrains sur lesquels investir des centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euros pour protéger. Fixer le trait de côte n’a pas beaucoup d’intérêt. Et donc, le Conservatoire du littoral teste des approches d’adaptation plus douces, plus flexibles, dans lesquelles il protège ses voisins des submersions en faisant des digues à l’intérieur des terres. Mais il autorise finalement l’eau à rentrer dans certains de ces terrains. Pas tous, mais il y a des choses qui sont gérées de manière beaucoup plus fine, au cas par cas, etc. Avec quelquefois des conflits d’usage, mais quand même souvent des bénéfices, notamment pour la biodiversité, pour tout ce qui est en fait poissons, oiseaux, etc. Et donc ça, c’est une. C’est quelque chose qui est très important, c’est ce qu’on appelle, en fait, un petit peu les “petites victoires”, là, les.
En fait, si vous voulez, si vous regardez l’adaptation, comment on fait pour aller vers l’adaptation transformationnelle ? On a plusieurs stratégies.
Il y en a une, c’est finalement de commencer par des, des petites victoires, des succès locaux qui après deviennent de plus en plus gros parce qu’on les met en réseau avec d’autres succès locaux. Et là, c’est ce qui est en train de réussir. Le Conservatoire du littoral, c’est de passer d’une expérimentation à quelque chose qui devient presque un projet pour l’ensemble de l’établissement, qui maîtrise quand même 18 % du trait de côte français.
L’assurance face aux risques climatiques
– Alors, des digues, ça, c’est des solutions d’ingénierie, mais qui peuvent apparaître nécessaires et qui vont être aussi coûteuses, des déplacements parfois de ponctuels localisés de populations. Et puis donc tu l’évoquais, de évidemment, d’accepter les mouvements de la nature là où c’est possible. On entend parler souvent de solutions fondées sur la nature. Est-ce que par rapport à ce risque de, de montée des eaux, il y a une gestion, je pense aux mangroves, forestière qui peut améliorer les, les conditions.
– Alors un petit mot sur les digues d’abord.
Quand vous regardez le rapport du GIEC, La digue, c’est en fait du point de vue des écosystèmes, c’est souvent une maladaptation. Pourquoi ?
Parce qu’en fait, on a besoin d’espace pour réaliser cette digue. Et souvent, en fait, elle se fait au détriment des écosystèmes. Mais ça, c’est du point de vue des écosystèmes. Si vous regardez la mer du Nord aujourd’hui, toute la côte de la mer du Nord est protégée de manière massive, pas que par des digues, mais aussi par des dunes, etc. Mais enfin, il y a quand même des digues, il y a des barrières estuariennes et c’est difficile d’imaginer autre chose en fait, pour des pays comme la Hollande qui sont en dessous du niveau de la mer. Donc, on ne peut pas parler de maladaptation systématique en fait. C’est-à-dire que du point de vue en fait. En gros, pour les villes, effectivement, on va plutôt vers de la protection en fait. Voilà.
Et à court terme, on peut avoir aussi une technique qui s’appelle l’accommodation, qui consiste en fait à rehausser certains bâtiments, des systèmes électriques pour éviter que, lorsqu’il y a des submersions, il y ait des dommages. Donc, ça, c’est une technique intermédiaire qui permet de gagner du temps, en fait. Donc, sur les digues, il y a quand même une inquiétude par rapport au fait que si c’est la réponse unique à l’élévation du niveau de la mer, l’adaptation va se faire au détriment des écosystèmes. Donc, d’où l’intérêt de solutions fondées sur la nature.
La solution fondée sur la nature. Elle va consister à dire, on a des systèmes naturels qui ont tendance à s’ajuster à des changements de niveau de la mer, de tempêtes, etc. Et qui vont nous rendre un service, qui sont qu’ils vont nous protéger pendant les tempêtes ou de l’élévation du niveau de la mer. Alors, c’est le cas effectivement, par exemple, pour les mangroves, en fait, qui créent une certaine rugosité lors des tempêtes qui font que la submersion est moins forte. C’est le cas pour les dunes. Donc, si vous avez de la végétation sur les dunes, ça favorise la création de ces dunes. En fait, c’est dunes. En fait, la végétation stabilise le sable qui est soufflé par le vent sur ces dunes. Et donc on a des dunes plus grosses et elles font tampon. En fait, lorsqu’il y a une tempête, vous avez une érosion de la dune et puis après la dune se reconstitue.
Alors, il y a des limites. C’est-à-dire que, à nouveau, une élévation du niveau de la mer qui va trop vite. Vous avez un système qui peut basculer également. Ça, ce sont les travaux en Amérique sur des systèmes qui sont souvent des systèmes de bande sableuse, entre une espèce de lagon à l’intérieur et puis la mer. On peut avoir des bascules. Donc tout ne marchera pas à n’importe quel niveau d’élévation au niveau de la mer. Mais à court terme, ces solutions fondées sur la nature, elles apportent beaucoup de bénéfices, surtout dans un contexte où on a des écosystèmes qui sont en déclin très rapide, notamment les écosystèmes aquatiques, estuariennes et côtiers, en fait. Donc donc, donc, d’où l’intérêt.
Alors maintenant, je pense qu’il ne faut pas limiter les solutions fondées sur la nature aux seules réponses de relocalisation. En fait, il y a des travaux qui portent sur tous les systèmes de barrières estuariennes.
Aujourd’hui, dans le monde, il y a énormément d’intérêt pour ces barrières estuariennes parce que, en fait, on a une augmentation des, des submersions à marée haute du fait de l’élévation au niveau de la mer, et on ne connaît pas très bien les effets de ces barrières sur les écosystèmes dans les estuaires. En fait, on sait qu’il y a des cas où, par exemple, aux Pays-Bas, en laissant des systèmes extrêmement ouverts qui ne sont fermés qu’en dernier recours, on arrive à préserver, par exemple, un système estuarien dans lequel on peut continuer à faire de l’aquaculture.
Donc, il y a des bénéfices pour les écosystèmes qui sont également des bénéfices pour les gens qui font de l’ostréiculture, etc. Donc, donc donc, je pense que ces questions de solutions fondées sur la nature, il faut vraiment essayer de les associer systématiquement, en fait, de les, de les, même dans les cas qui sont en fait assez nombreux, où on va investir dans des digues, des barrières estuariennes, des protections pour, pour se protéger de l’élévation du niveau de la mer, bien faire attention à les designer de telle manière qu’il y ait des possibilités pour les écosystèmes de, de, d’avoir des habitats tout simplement.
Donc, on prend les solutions, on comprend les limites de certaines solutions et que c’est un ensemble à prendre en compte et à toutes les échelles politiques et territoriales.
– Les inondations, le risque de feux de forêts, de tempêtes aussi, le changement climatique augmentent la fréquence et la violence des catastrophes météorologiques et naturelles. Les assureurs travaillent beaucoup sur ces sujets, car il y a un enjeu à pouvoir maintenir des conditions qui permettent d’assurer les biens et les personnes. Aussi, penses-tu que c’est l’un des moteurs qui va permettre une adaptation réussie sur le plan collectif, face à la nécessité de rester dans un monde assurable ?
– Donc l’assurance, c’est en fait, c’est plutôt une réponse à des pertes et des dommages. C’est-à-dire qu’on a des pertes, on a des dommages, donc on n’est plus dans l’adaptation. On constate qu’on a eu des pertes et des dommages et on se pose la question de comment on répartit ces pertes et dommages. Donc, le pire qui puisse arriver, c’est que, en fait, celui qui a perdu quelque chose perde tout et qu’il n’y a aucun mécanisme pour l’aider.
En fait, l’assurance, c’est un des mécanismes qui permet, en fait, de compenser ces pertes.
Alors effectivement, ce qu’on voit aujourd’hui, c’est une augmentation des coûts de l’assurance des catastrophes climatiques. On le voit en France pour les retrait-gonflement des argiles, parce qu’on a des sécheresses de plus en plus intenses. Et donc là, par exemple, en 2022, on avait plus de trois milliards de pertes sur le retrait-gonflement des argiles liées à la sécheresse de 2022.
Alors, on hérite d’une situation où, en fait, on a eu un développement de pavillons en périphérie sur des argiles qui ont des fondations qui sont peu profondes et donc qui sont très vulnérables à ce phénomène. Mais s’il n’y avait pas de sécheresse, il n’y aurait pas ce problème de trois milliards de pertes. Donc, on est vraiment sur un phénomène qui est lié au changement climatique.
– C’est-à-dire que ça occasionne des fissures, des dommages sur les sur les maisons ?
– Exactement. C’est-à-dire qu’il y a les argiles se gonflent pendant les périodes humides et se rétractent pendant les périodes sèches, et ça crée des fissures sur les maisons qui sont généralement très coûteuses. ça peut, ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire rendre des bâtiments complètement inhabitable, en fait.
Donc, ce sujet-là, il est. Et puis ça affecte les routes également. Ça, on ne le sait pas parce que c’est pas assuré et puisqu’on ne le voit pas dans les comptes publics, c’est intégré dans toute une série de rénovations des routes, mais enfin ça affecte les routes. Et au bout d’un moment, les collectivités se posent aussi des questions sur les coûts pour rénovation des routes.
Bon, enfin, retrait-gonflement des argiles, c’est un premier sujet qui inquiète très fortement les assureurs. Il y a également la grêle. En fait, la grêle, ce qui se passe, c’est que vous avez des grêlons qui sont plus gros liés au changement climatique. On a en fait, lorsqu’on a. Avec le changement climatique, on a plus d’humidité dans l’atmosphère. Pendant les orages, les grêlons se forment plus haut et ils retombent plus gros et les dommages sont très corrélés au à la taille des grêlons. Donc on a également l’assurance sur la grêle qui qui augmente très fortement. On sait que tôt ou tard on va voir les inondations par ruissellement sur la grêle.
La transition juste et le financement de l’adaptation
– On peut prendre l’exemple récent de la région parisienne. Alors c’est vrai que quand la grêle tombe, selon où elle tombe, les dommages ne sont pas les mêmes. Mais là, c’était en plein en pleine métropole. Il y a eu énormément de coups sur les carrosseries des voitures. Ça peut paraître anecdotique, mais c’est en dizaines de millions d’euros.
– Et c’est pas, c’est pas anecdotique parce que, en fait, effectivement. Alors, de mémoire, on est autour de 400 millions d’euros historiquement par an sur ces dommages grêle, et on a plusieurs événements au-dessus du milliard, plusieurs années, au-dessus du milliard ces dernières années. Donc c’est c’est pas anecdotique, mais c’est pas un sujet sur lequel il y a énormément de problèmes d’assurabilité. Parce que finalement, c’est beaucoup des assurances voitures avec des, en fait, des coûts qui sont de toute façon extrêmement importants sur les accidents, sur toutes ces choses-là qui font que c’est un petit peu. C’est assurable.
Retrait-gonflement des argiles, par contre, il y a eu un problème d’assurabilité qui était que le système qui est en France aujourd’hui est un système en fait public, privé de réassurance où en fait, on a la Caisse centrale de réassurance qui rassure des assureurs privés. Et cette caisse centrale de réassurance en fait arriver au bout du système de financement actuel où en fait elle reçoit, elle est financée par une surprime dont le montant est décidé par décret.
C’est la raison pour laquelle il y a une première réponse a été d’augmenter cette surprime et augmenter la surprime.
En fait, ça veut dire que vous payez plus sur votre prime, sur votre assurance habitation et automobile. Ça, c’est une réponse à court terme.
La vraie réponse à long terme, si on veut réduire les risques, c’est adapté. C’est l’adaptation.
C’est l’adaptation qui va permettre en fait, d’éviter l’augmentation de ces risques. Sinon, au bout d’un moment, il y aura un consentement à cette assurance habitation qui va être plus limitée, en fait, parce que ces coûts vont augmenter considérablement. Donc, l’assurance, ça peut être une réponse d’adaptation, mais c’est une réponse d’adaptation qui est quand même présente des risques. Elle présente le risque que, d’une part, il y ait une exclusion des plus pauvres de ce système d’assurance. Donc, ça, en France, je dirais qu’on est quand même plutôt des bons élèves parce qu’avec ce système, quand on a un taux de couverture qui est exceptionnel par rapport au reste du monde. On est à plus de 75 %.
Mais, mais bon, ça peut se fragiliser. Et puis en fait, il y a également un risque qui est que l’assurance, finalement, vous ne vous incite pas beaucoup à vous adapter. C’est-à-dire que, à partir du moment où vous savez que vous êtes couvert pour vos pertes et dommages, ben vous n’allez pas avoir un intérêt très fort à s’adapter. Donc du coup, il y a quand même la question de dire pour les acteurs qui le peuvent, donc par exemple, les propriétaires de résidences secondaires, les personnes qui vont avoir ou les entreprises qui ont des biens de luxe, comment peuvent elles contribuer à la. à l’adaptation. Et donc ça, c’est l’objet d’un rapport qu’on a rendu en 2024, donc au ministère des Finances et au ministère de l’Environnement, dans lequel on a toute une série de recommandations pour faire en sorte que l’assurance, elle joue un rôle aussi pour l’adaptation et aussi, dans une certaine mesure, pour l’atténuation, en étant réaliste sur les capacités des assureurs qui ont des contrats annuels, donc qui peuvent être résiliés tous les ans et qui pour lesquels l’engagement sur le long terme est difficile à organiser en fait.
Donc, il y a besoin d’association pour, en fait, que les assureurs, collectivement, apportent des informations précises à leurs assurés sur comment faire pour s’adapter en pratique contre ces événements. Voilà donc ce qui nous pend au nez. C’est effectivement des submersions marines, c’est l’inondation et ce qui est déjà là, c’est les retrait-gonflement des argiles. Il y a un autre système d’assurance qui est l’assurance récolte. l’Assurance récolte, elle a été réformée en 2023 ou 2024 et l’assurance récolte, en fait, elle vise à. Elle est très fortement subventionnée, 70 %. Et en fait, ce qui se passe, c’est qu’elle vise à dire que quand il y a une catastrophe climatique, donc, il y a une dizaine ou une douzaine de risques climatiques, sécheresse, pluie, chaleur, etc. Eh bien les agriculteurs qui sont assurés, l’assurance n’est pas obligatoire, vont être vont être couverts sur la base des cinq dernières années, en fait, les trois meilleures années de ces cinq dernières années.
Alors, ce système, en fait, aujourd’hui, il n’est pas accessible à tous les agriculteurs. Clairement, un maraîcher bio va avoir beaucoup de mal à utiliser ce système. Et un agriculteur qui va être plutôt en céréales avec des grosses surfaces, lui, ce sera plus intéressant. C’est un système en fait qui est pas très incitatif, en fait, à l’adaptation, parce que qu’est-ce que c’est, l’adaptation dans le domaine agricole ? C’est d’abord, en fait, aller vers des pratiques agroécologiques, vers des solutions qui vont utiliser, va mobiliser des réductions de la demande en eau, donc un petit peu de sobriété, plus d’efficacité, etc. Et donc c’est un système qui ne comprend pas de conditions pour aller vers ces options. Donc aujourd’hui, l’assurance récolte, c’est, c’est un dispositif pertes et dommages qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui n’a pas ces incitations à aller vers l’adaptation. Oui. D’où l’intérêt, en fait, de s’intéresser beaucoup à ces mécanismes de compensation, de pertes et dommages que sont l’assurance, pour faire en sorte en fait, que leurs effets potentiellement négatifs, ils soient. Ils soient limités, en fait, et c’est l’objet de toutes les recommandations qu’on a pu faire dans ce rapport-là dont je parlais. Et puis également, il y a le Haut Conseil pour le climat, qui fait des recommandations un petit peu.
– Je mets toutes les ressources dans la description de l’épisode pour les auditrices, les auditeurs qui veulent aller plus loin.
On évoque donc les biens assurables, on entend parler d’euros, de millions d’euros. Cela m’amène à parler d’un dernier point que tu as évoqué, tout en fil rouge les inégalités économiques face à la nécessité de s’adapter. Même si le temps nous manque, que peut-on dire dessus ?
Parce que ces investissements sont colossaux.
Alors qui doit les faire pour pour aller à l’essentiel ?
Ce sont ces investissements collectifs ou il y aura forcément une part pour les citoyens à titre individuel ou les entreprises ?
– Alors là aussi, c’est pas mon sujet de recherche, mais clairement, il y a ce sujet. En fait, qu’est-ce que c’est la transition juste ? La transition juste. Effectivement, c’est une transition qui va faire attention en fait, aux plus vulnérables, donc les plus vulnérables qui sont les premières victimes du changement climatique.
C’est eux qui habitent dans les passoires thermiques qui potentiellement, en fait, dès qu’il y a une, ben voilà, en fait, ils n’ont pas les moyens financiers de se protéger, etc. Donc, comment on fait ? Donc ça, c’est un premier sujet.
Il y a un deuxième sujet qui est aujourd’hui, on est dans une situation où les finances publiques ne sont pas en très bonne santé. Donc, on anticipe effectivement qu’il y ait une contribution importante du privé et des particuliers pour l’adaptation et pour l’atténuation, en fait.
Donc, en général, sur l’atténuation, il y a à peu près l’estimation qui avait été faite par le rapport Pisani – Mahfouz, c’était qu’on avait besoin de entre 60 et 70 milliards d’euros par an supplémentaires pour la, pour, pour, pour, pour la transition et que c’était moitié privée, moitié publique.
Dans la situation actuelle, en fait. Voilà pour l’adaptation. Les chiffres ne sont pas très clairement établis en fait. Il y a il y a un institut qui s’appelle I4CE, qui est un institut français, l’Institut for Climate Economics, mais qui est français, qui, qui qui fait des estimations. Mais aujourd’hui, on n’arrive pas à avoir un paysage complet en fait.
Aujourd’hui, on sait que, par exemple, l’ordre de grandeur pour l’adaptation dont on aurait besoin de manière immédiate, et on le sait depuis 2022, c’est autour de deux, trois milliards d’euros. C’est un ordre de grandeur au niveau national.
Et après il y a les collectivités.
Donc en fait, on ne parle pas de centaines de millions d’euros, on parle en milliards d’euros.
Et en fait, moi, ce que j’ai tendance à dire, c’est évidemment, je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, je ne suis pas un spécialiste, mais en fait, c’est un sujet sur lequel on n’a pas vraiment le droit d’échouer en fait, parce que c’est l’avenir des enfants.
C’est une question de justice intergénérationnelle. Donc, si on veut, en fait, la question, c’est pas de savoir est ce qu’on a l’argent de faire tout ça ? C’est comment on fait pour trouver cet argent ? Est-ce qu’on dépense, est-ce qu’on investit dans les bons secteurs ? En fait, et aujourd’hui, ce qui me va, ce qui était peut-être intéressant, c’est que ces enjeux d’adaptation, ces enjeux d’adaptation, ils rejoignent les enjeux de souveraineté.
On est dans un dans un moment où on ne peut pas beaucoup compter sur la solidarité internationale pour nous aider collectivement à nous sortir, donc réduire notre dépendance au pétrole, réduire nos vulnérabilités, réduire les risques, c’est nous protéger en fait.
Donc, je pense vraiment que il y a vraiment un intérêt très fort aujourd’hui à investir sur ces sujets là, sur l’adaptation. Cet institut, I4CE, il lève quand même un sujet qui est quand même pas anodin, qui est que, aujourd’hui, quand on regarde les investissements publics, on trouve cinquante milliards d’euros par an d’investissements publics qui sont potentiellement vulnérables au changement climatique et dans lesquels on ne trouve aucune trace d’une prise en compte du changement climatique ou de mesures d’adaptation. Donc ça montre un petit peu le chemin qui reste à faire quand même.
Conclusion
– Donc une forte prise en compte du sujet à faire évoluer, y compris et peut-être même d’abord au sein des politiques publiques et de leur, et de leurs effets et de leurs impacts. Gonéri Le Cozannet. Chercheur et co-auteur du rapport du GIEC qui était dans Soluble(s). Je renvoie à nos auditrices et nos auditeurs. Je le disais à la description de l’épisode, avec des liens utiles pour aller plus loin, mais on peut garder le fil et le contact avec toi, notamment sur le réseau social LinkedIn où tu publies régulièrement.
– Exactement.
– Merci. Merci beaucoup d’être passé dans Soluble(s).
– Eh bien merci pour cette invitation.
– Voilà, c’est la fin de cet épisode. Si vous l’avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt !
POUR ALLER PLUS LOIN
- Le site du GIEC en français
- Le plan national français d’adaptation (PNACC-3 – 2025)
- Avis 2025 du Haut Conseil pour le Climat sur le PNACC-3
- Géorisques : panorama des risques naturels
- Visualisation de l’élévation du niveau marin (BRGM)
TIMECODES
00:00 Introduction
01:42 Le parcours de Gonéri Le Cozannet
02:45 Pourquoi l’adaptation est indispensable même en luttant contre le réchauffement
06:38 Impacts des vagues de chaleur et nécessité d’anticiper
08:56 La climatisation et la maladaptation
12:36 Les risques clés pour la France
16:16 L’adaptation et les élections municipales 2026 en France
19:24 Relocalisation de Miquelon : un exemple concret d’adaptation territoriale
28:02 Digues & Solutions fondées sur la nature
32:23 Les assurances et les sinistres climatiques
40:48 La transition juste, c’est quoi ?
44:14 Merci à Gonéri Le Cozannet
44:58 Fin
_
Ecouter aussi
L’adoption des coraux : une solution pour préserver les écosystèmes marins
30 000 citoyens “Shifters” pour décarboner la France face à l’urgence climatique
De moins en moins blanche, la montagne peut-elle devenir plus verte ?
Canicules, inondations, tempêtes, feux de forêt : comment s’y préparer – Avec la Croix-Rouge