Il n’y a plus de frontière nette entre la vie réelle et le monde numérique. Pour Soluble(s), François Saltiel, journaliste et producteur à France Culture, spécialiste du numérique, décrypte le quotidien des familles françaises connectées et partage ses clés pour renouer un rapport apaisé, lucide et constructif aux écrans. Co-auteur, avec Virginie Sassoon (CLEMI), du livre « Faire la paix avec nos écrans » (Flammarion), il s’appuie sur leur expérience familiale : une adolescente de 17 ans, deux garçons de 9 et 6 ans, et près de dix appareils connectés à la maison.
📄 Résumé
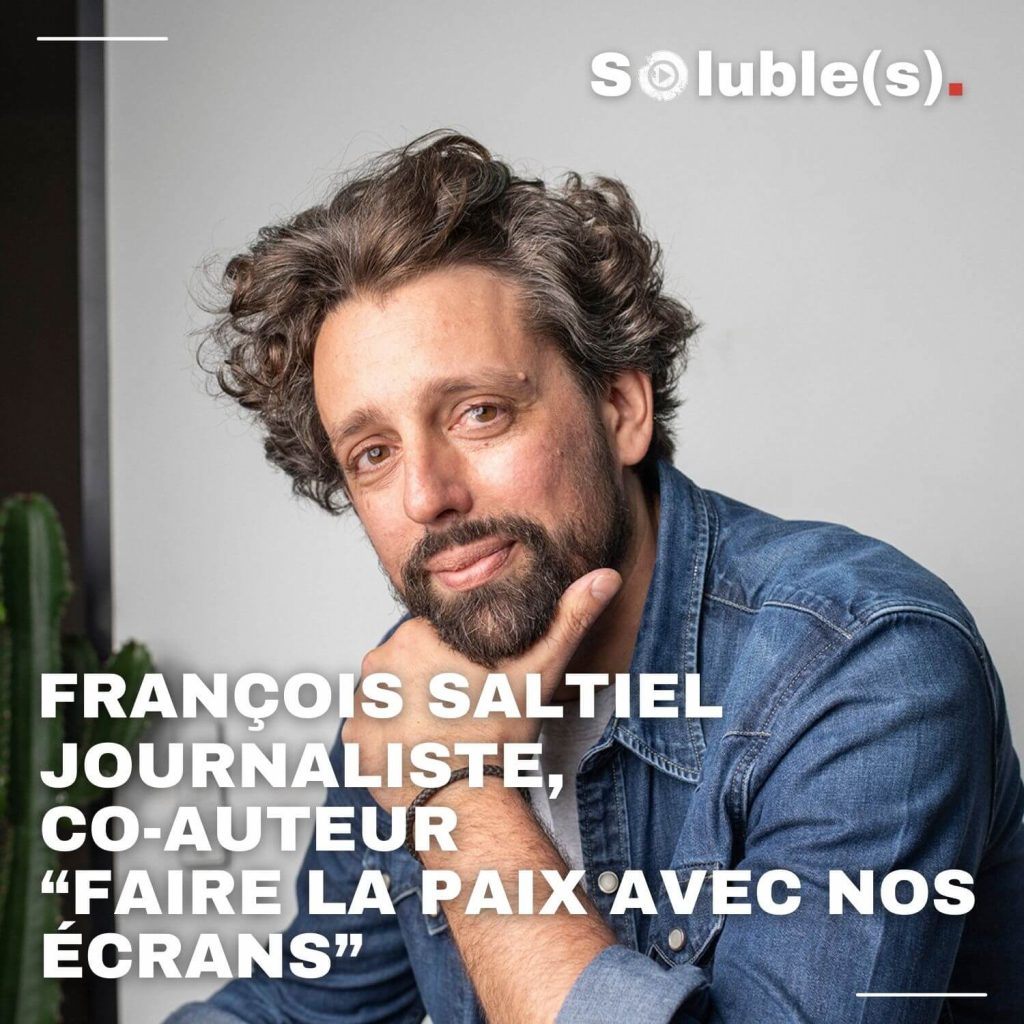
DR.
Transcription (automatisée)
– Simon Icard : Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble(s). Aujourd’hui, on se demande comment faire la paix avec nos écrans quand on vit dans un foyer avec dix appareils connectés et trois enfants qui grandissent entre YouTube, FIFA et Instagram. Ce n’est pas mon histoire, mais la question que s’est posée mon invité. Et vous allez l’entendre, des solutions sont là. Bonjour. François Saltiel !
– François Saltiel : Bonjour Simon !
– Simon Icard : Tu es un journaliste, producteur spécialiste des enjeux numériques. On t’entend chaque matin sur France Culture dans « Un monde connecté » et le vendredi à quatorze heures pour « La Fabrique de l’information ». Tu signes un ouvrage écrit en couple avec Virginie Sassoon, qui est la directrice adjointe du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, le CLEMI. Vous avez trois enfants. Votre essai est très documenté, mais il est accessible à tous. Il est paru chez Flammarion. Il s’intitule donc « Faire la paix avec nos écrans ». On va parler de cette bataille familiale, des solutions qui marchent et aussi de l’espoir que ça s’améliore car tout le monde est concerné. On va plonger dans cette guerre qui se joue autant dans l’espace public qu’au cœur des familles. Tu nous diras si ta famille, justement, est parvenue à trouver des solutions auxquelles aspirent quasiment tous les parents, enseignants et même, je le pense, les enfants et les adolescents eux-mêmes.
François Saltiel : parcours et révélation du numérique comme fenêtre sur le monde
Mais d’abord, je me montre toujours curieux du parcours de mes invités en début d’épisode. François, je le disais, tu es un spécialiste du numérique. C’est une spécialité dans ton métier de journaliste. Parle nous un peu de ce qui t’a amené à ça, si tu le sais.
– François Saltiel : Oui, je le sais par la… la force des choses. Moi, j’ai commencé à m’intéresser au numérique en deux mille quatorze, deux mille quatorze, deux mille quinze, lorsque j’ai été chroniqueur sur 28 Minutes, l’émission d’Arte qui passait tous les soirs. Et j’avais une chronique quotidienne où tous les soirs, il fallait que je raconte en trois minutes une histoire plutôt décalée sur l’actualité. Et c’est à ce moment là où je puisais pas mal mes sujets sur l’espace numérique qui était encore, tu vois, c’était il y a presque dix ans, assez méprisé. C’est-à-dire qu’on considérait que sur YouTube, tu avais que des contenus divertissants, que c’était encore un espace qui était puéril, infantilisant. Et petit à petit, moi, j’ai vu quand même qu’il y avait beaucoup de sujets sociaux et politiques qui montaient sur ces plateformes-là. Donc je me suis, j’ai commencé à m’emparer d’Internet comme une fenêtre sur le monde, tu vois quelque chose qui racontait le monde. Et donc tous les jours, à force de parler du numérique et d’arriver à convaincre aussi l’audience d’Arte qu’il peut y avoir une dimension géopol’ du numérique. Et puis, sur ce sujet, Donald Trump m’a pas mal aidé puisque quand il est arrivé sur son premier mandat, en deux mille seize, on voit à quel point les réseaux sociaux ont été un outil de propagande de sa politique. Sans parler du scandale Cambridge Analytica. Et donc, très vite, le numérique est devenu un espace essentiel de notre société. C’est comme ça que j’ai continué à m’y intéresser.
– Simon Icard : C’est ta grille de lecture pour comprendre et expliquer le monde. On est fin deux mille… , fin deux mille vingt-cinq, quasiment fin novembre. En tout cas, ça fait quatre-vingt-dix ans que la télé existe en France, trente-et-un ans qu’on a le web grand public, dix-huit ans nous séparent du premier smartphone. Vingt ans pour YouTube et tout juste trois ans pour ChatGPT selon les dates, qu’on soit en France ou à l’étranger. Parmi tous ces écrans, lequel a selon toi le plus bouleversé nos vies quotidiennes ici en France ?
– François Saltiel : Alors c’est une bonne question. C’est ce qu’on essaie de faire justement dans cet ouvrage. Dans la première partie, « L’histoire des écrans », je dirais que le smartphone, évidemment, tu l’as cité qui va bientôt fêter ses vingt ans. l’iPhone est créé en deux mille dix-sept, ce sera en deux mille vingt-sept, il aura vingt ans. C’est sans doute le téléphone qu’on appelle, nous, dans le livre : « L’écran total », qui arrive en fait à cumuler toutes les techniques et tous les procédés des écrans préexistants. C’est-à-dire que tu vois, là, c’est pas le smartphone qui a inventé la captation de l’attention, tu l’avais déjà sur l’écran de la télévision avec la phrase de Patrick Le Lay, le patron de TF1 de l’époque, qui disait vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola comme étant sa mission. Mais on va dire qu’avec le smartphone, ça a amplifié ce phénomène-là, puisque notre captation d’attention est maintenant constante vingt quatre heures sur vingt quatre et plus personnalisée. L’interaction, c’est l’ordinateur qui l’a créée, mais tu l’as évidemment sur le smartphone. Donc en fait, le smartphone est un amplificateur de toutes les techniques préexistantes. Donc je dirais que c’est celui-là, cet outil-là, cet écran-là qui est le plus prédominant et bouleversant en France comme dans le monde.
Parentalité numérique et « technoférence » : le rôle de gendarme et de dealer
– Alors ton livre avec Virginie Sassoon, part à la fois d’une réflexion professionnelle mais aussi très intime chez vous. Il y a une ado de dix sept ans et deux garçons de neuf et six ans. Quelle place occupe vraiment les écrans à la maison aujourd’hui dans votre foyer ?
– Comme tout le monde, une place importante, en tout cas, autant dans les esprits que physiquement. C’était intéressant pour nous, tu vois justement d’alterner à la fois une expertise personnelle et une expertise professionnelle. Parce qu’on est. On a beau être experts du sujet, on galère comme tout le monde. Donc l’écran nous oblige parfois, nous en tant que parents, à alterner un rôle de gendarme et de dealers. Ce qu’on dit dans le dans l’ouvrage, je pense que ça parle aux gens. Dealer de temps d’écran et en même temps, dealer parce qu’on sait très bien que ce temps d’écran permet aussi aux parents de faire autre chose et d’avoir aussi des moments pour eux et, gendarmes parce qu’on se rend compte que cet écran peut être dévorant dans leur attention et qu’il faut savoir le mettre à sa juste distance et équilibre. Donc on est dans une. On est une famille connectée, consciente de ses dangers, mais aussi de ses facteurs positifs, tu vois ? On sait très bien que le numérique peut être un outil d’émancipation autant que d’aliénation, il faut savoir faire preuve de ‘technodiscernement’. C’est ce qu’on essaye de faire en tous cas au sein de notre famille.
– Du (thechno) discernement. On est tous ultra-connectés et pourtant on doit les parents doivent inventer une nouvelle forme de parentalité, la parentalité numérique. C’est un nouveau mot, une nouvelle expression. Il n’y a pas de mode d’emploi là aussi pour la parentalité. Mais comment tu définis ça en quelques mots ? La parentalité numérique ?
– Oui, tu as raison, parce qu’en fait, on est la première génération de parents à devoir être confrontés justement au numérique et qui a bouleversé la sphère familiale. On est. On n’a pas forcément grandi avec nous, on a connu les deux mondes et par contre nos enfants ont grandi avec. Donc, on a la première génération de parents à devoir gérer ça. Déjà, je pense qu’il n’y a pas de mode d’emploi pour être parent tout court. Il y a encore moins de mode d’emploi pour être parent à l’ère du numérique. Donc on découvre, on apprend en marchant. Donc on développe plusieurs petits outils ou solutions pour essayer d’y faire face. Mais c’est vrai que il faut prendre conscience de cette, de ce phénomène inédit pour nous de la première génération à devoir parler de Snapchat avec ses enfants, être confronté au cyberharcèlement, à la captation de l’attention constante à la « technoférence » et à la manière dont les écrans interfèrent dans notre relation. Donc on est, on est les premiers.
– C’est une génération de pionniers. « On » : les parents et les enfants aussi quelque part.
Alors pour rappel, les chiffres, selon le dernier baromètre du numérique, il y a en moyenne dix équipements avec un écran par foyer. Le temps d’écran est jugé trop lourd, trop présent par quarante deux pour cent des Français. Donc c’est une auto critique des personnes interrogées dans le baromètre fait par le Crédoc. Côté santé, Santé Publique, France rapporte que quasiment cent pour cent des trois à onze ans sont exposés aux écrans, surtout à la télévision, et que le temps d’écran, lui pour les mineurs augmente considérablement de tranche d’âge en tranche d’âge. Dans le livre, tu le disais, vous avez cette image forte les parents sont parfois devenus des « dealers d’écrans sans savoir exactement ce qu’ils mettent entre les mains de leurs enfants ». Alors la question est simple on a globalement l’impression que les dangers de la surexposition sont connus. Mais pourquoi le public se sent pas assez, peut être aidé, informé, en tout cas livré à lui-même ?
– Ça c’est très vrai. C’est-à-dire que quand on rencontre les parents parce qu’on en a interrogé beaucoup dans le cadre du livre. On sent un sentiment d’impuissance et de débordement. C’est-à-dire que déjà, il y a plusieurs fausses croyances. Tu sais, il y avait toute cette idée où on pensait que l’espace extérieur, les villes, la rue est un espace dangereux, que l’espace intérieur était celui de la sécurité. Donc on a laissé beaucoup les enfants à l’intérieur des maisons, à l’intérieur des appartements, à l’intérieur de leur chambre, en leur confiant justement cet outil qui était une fenêtre sur le monde et qui est un déplacement qui se fait plus de manière horizontale ou qui va sortir sur l’espace terrestre et tangible, mais vertical, c’est-à-dire le scroll où tu vas aller naviguer dans l’espace numérique en pensant que cet espace numérique était plus ou moins sain, puisqu’il y a plusieurs études qui montrent que la plupart des parents ne savent pas ce que les enfants font sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Or, évidemment, cet espace, il est. Il a beaucoup plus de dangers qu’on peut l’imaginer et on a mis du temps à prendre conscience qu’il fallait s’y intéresser. Donc là, c’est la première chose. Donc il y a eu, à mon avis, un retard à l’allumage par rapport à ces outils-là. Aussi, une forme de mépris, c’est-à-dire, on se disait bon bah finalement ce qu’ils font sur internet, c’est pas beaucoup de valeur, Or ça a de la valeur positive comme négative. On a cru aussi pendant longtemps qu’il y avait une « fausse vie » et une « vraie vie ». On disait d’ailleurs, on se voit dans la vraie vie. Ce qui voulait dire que le monde numérique était une fausse vie. En fait, c’est pas une fausse vie. Quand tu te fais par exemple cyberharcelé, tu te fais harceler dans ta vie vraiment, quand tu te fais insulter, tu te fais insulter, menacer de mort, tu te fais menacer de mort. Quand tu vis aussi des expériences de sociabilité fortes, tu les vis vraiment. Donc on a longtemps cru un peu au mirage de la virtualité. Or, ce monde virtuel, il est tangible dans nos émotions, et c’est ce qu’on en parlera sans doute tout à l’heure. Ce qu’on essaie de décrire avec un néologisme, puisqu’on parle de société « amphinétique » pour parler justement de ce continuum de nos vies, on alterne moments connectés, moments déconnectés. Donc, on en a conscience, on en prend conscience, mais c’est assez récent. Et pour résumer, tu vois, on a eu aussi, concernant les réseaux sociaux, une première décennie d’enchantement. C’est-à-dire : c’est génial ces nouveaux outils qui nous permettent d’être tous médias, d’être connectés les uns aux autres à un moment critique. Affaire Snowden, Cambridge Analytica. Ça, c’est la deuxième décennie. Et aujourd’hui, on en est là à un moment où ce que nous, on appelle justement une maturité critique pour arriver à être conscient des dangers, mais pour autant arriver à transformer cette expérience comme étant la plus vertueuse possible.
Amphinétique et écran partagé : s’intéresser à la vie en ligne des enfants
– Oui, cette expérience, ses ressentis, ses sensations et même, j’allais dire : la vie quotidienne. Il n’y a plus de séparation ressentie entre l’espace extérieur et le monde numérique. Tu le disais, vous insistez beaucoup sur sur ce point d’ailleurs, pour le meilleur comme pour le pire. On a parlé des dangers, mais il y a aussi pour le meilleur. C’est important de réussir à partager, en tout cas à s’informer sur les expériences que vivent nos enfants sur ces réseaux sociaux là, de ne pas juste les laisser faire, mais peut être de se montrer curieux. Un peu comme quand on raconte, on demande de raconter sa journée à l’école ?
– Exactement. Dans le livre, on le dit, Tu vois, on pose souvent la question à ses enfants comment s’est passée ta journée ? On pourrait aussi poser la question Comment s’est passée ta journée en ligne ? C’est à dire qu’est ce que tu as fait ? Qu’est ce que tu as vu comme images ? Qui tu as rencontré ou quel moment a été plaisant ? Qu’est ce que tu as appris, Qui tu as rencontrer, Avec qui tu as parlé ? Donc oui, je pense qu’une des clés, c’est déjà d’arriver à ne pas dévaluer la teneur et le contenu des expériences que l’on fait en ligne, notamment chez les adolescents. Ça a de la valeur, en fait, ce qu’il faut, donc il faut s’y intéresser et ensuite on s’y intéressant on peut mieux comprendre aussi les émotions qui les traversent. Et surtout, on peut faire des écrans, un écran partagé, tu vois, un écran où on peut ensemble, adultes comme adolescents, partager nos expériences réciproques, nos curiosités pour maintenir le dialogue. Parce que, en fait, le livre parle beaucoup de la question du lien et l’écran individualisé qui est celui du smartphone. Tu vois, à l’inverse du cinéma dont on parle aussi quand on parle de la grande histoire des écrans, dans une moindre mesure de la télévision, étaitent tout de même des écrans communs. Et donc, comment on arrive à vivre dans une société individualiste qui prône aussi la consommation très personnelle et individuelle et en silo en fait, de nos écrans ?
La méthode P.L.A.Y. : Partager, Libérer, Accueillir, Yes/No et exemplarité
– Allez, on va aller plus en détail dans les solutions. Commençons par celles qui sont à la main des gens. On parlera ensuite de celles qui sont plus sociétales ou politiques. Avec Virginie Sassoon vous avez créé une méthode au nom facilement mémorisable. C’est simple, c’est P.L.A.Y. P Comme partager. L Comme libérer du temps sans écran. A Comme accueillir les émotions et le Y du mot play pour Yes or No pour poser des limites claires. Est ce que ça a vraiment changé les choses à la maison chez vous ? Concrètement, comment mettre ça en place ?
– Nous, ce qui a vraiment changé les choses à la maison, c’est la question de l’exemplarité. Parce qu’en fait, les enfants, je ne sais pas si tu en as, mais ce sont des fins négociateurs. C’est-à-dire que tu as tout ce que tu vas leur demander de faire, Ils vont arriver très vite à le retourner contre toi ! Tout ce que tu leur demandes ou tous les devoirs…
Donc, ils vont très vite aussi te mettre en accusation en disant, tu me demandes de faire ceci, cela, mais toi, tu es sans arrêt sur ton téléphone. Alors oui, c’est pour le travail, mais franchement, tu ne passes pas beaucoup de temps avec nous, tu es toi aussi happé, toi aussi accro, etc. Donc, tu vois, la première chose, c’est la question de l’exemplarité et. Et pour ça, c’est la question du du contrat. Nous, c’est ce qu’on fait en fait avec les enfants. On signe des contrats, mais tu vois, les contrats, ça engage les deux parties. Donc c’est plus toi contre les écrans, c’est toi et moi contre les écrans. Donc moi aussi je me rends compte qu’on est vulnérable. Tu vois, dans le livre, il y a tout un, il y a toute une approche sur l’accueil de nos vulnérabilités en disant, je suis vulnérable, tu es vulnérable.
Nous sommes tous vulnérables par rapport à ces outils qui ont été pensés comme tels, pensés pour exploiter les failles de notre cerveau, les failles de notre attention, de notre humanité finalement. Donc déjà, la première chose à la maison, c’est d’être exemplaire et de faire un pacte en me disant je te demande ça, mais je m’engage aussi à faire ça. Donc tu vois, faire des moments le L de Libérer, c’est libérer du temps en fait d’attention, en disant on ne va pas de téléphone à table. Pas de téléphone à partir de telle heure. Viens on les remplace aussi par un jeu de société ou par une activité commune. Parce qu’il y a aussi la question des alternatives. C’est que c’est bien joli de vouloir couper les écrans, mais encore faut-il avoir des solutions pour les remplacer et des alternatives qui sont désirables. Donc si tu veux, je peux te détailler le P.L.A.Y. en deux secondes. Le P c’est Partager comme tu l’as dit, faire en sorte que j’sais pas présente-moi. Un de tes préférés. Et puis moi je te parle aussi dans des films que j’adore, donc tu vois là on est dans le partage. Le L c’est Libérer ce temps d’attention en prenant conscience qu’aujourd’hui la sur-connexion peut être ringarde car pendant longtemps tu as été ringard d’être déconnecté. Nous on croit qu’il faut vraiment développer l’idée que c’est ringard d’être connecté tout le temps pour retrouver un peu la joie à la déconnexion. Donc le JOMO, à l’inverse du FOMO, le FOMO, la peur de manquer quelque chose, le Jomo, la joie d’être connecté. Accueillir les émotions, on en a parlé, c’est de ne pas dévaloriser les expériences qu’on vit en ligne. Et le Yes, c’est un cadre, mais un cadre qui doit être souple et adaptable. Et enfin, le cadre réciproque. Ce que je te disais dans la, dans l’exemplarité, si on arrive à peu près à mettre en ça, à mettre tout ça en place, on arrive au P.L.A.Y Et le play c’est aussi le jeu. On pense que toute cette approche en fait, ne peut pas fonctionner s’il n’y a pas une notion de plaisir. Tu vois, c’est pas punitif, c’est retrouver un goût de l’effort. Mais le goût de l’effort, c’est de le faire avec envie et de se rendre compte que c’est profitable pour tout le monde.
Dépendance aux plateformes et l’enjeu de l’interopérabilité
– Alors les lecteurs du livre le verront de suite. Il n’y a absolument pas de prescription. C’est un partage d’informations et de et d’expérience, mais c’est une invitation à la réflexion. On se demande comment réussir à détourner les yeux des écrans quand c’est nécessaire, alors que toutes les plateformes se battent pour capter notre attention et aussi celle de nos enfants. Mais tu informes aussi les lecteurs sur une autre forme de captivité. Nous sommes captifs des grandes plateformes, des réseaux sociaux et des messageries notamment, car elles gardent la main sur nos données. On connaît les géants Google, YouTube, Meta, TikTok, X et allons aussi dire pour Spotify, pour Deezer, sur lesquels vous écoutez probablement. Même si l’Europe durcit la régulation de ces plateformes, on reste donc captifs de leurs écosystèmes. Pourquoi c’est si difficile de s’en échapper en fait ?
– Alors ça, c’est une question compliquée. C’est si difficile parce qu’il y a ce qu’on appelle une puissance de l’usage, c’est à dire à partir du moment où ces outils ont été donnés, accessibles à tous gratuitement, même si tu sais bien que rien n’est gratuit, si c’est gratuit, c’est que c’est toi le produit, c’est à dire que ce sont tes données qui sont exploitées. Mais en fait, les entreprises de la Tech ont toujours le même système, elles délivrent un outil. Cet outil rencontre un usage et ensuite tu as la puissance de l’usage qui fait qu’on y construit des habitudes, un effet de réseau. On s’y implique et ensuite ça devient très difficile d’en sortir parce que le coût d’entrée, ce qu’on y a investi, ce qu’on a mis comme temps, en énergie, est si fort qu’on n’a pas envie d’en sortir et ensuite on a tellement pas envie d’en sortir qu’en Europe, on ne dispose pas non plus de beaucoup d’alternatives, on va dire de logiciels, d’outils, comme un réseau social par exemple. Donc on ne sait même pas où aller. Donc on y reste par habitude et parce qu’on a consenti à y livrer beaucoup de notre temps et de nos données. C’est pour ça qu’aujourd’hui, quand tu es un ado, tu vas quitter TikTok, quitter Snapchat, quitter la communauté que tu as formée, forgée et tes amis pour aller ailleurs. C’est pas simple parce que, en partant d’un réseau, tu as l’impression de quitter tes amis. Donc ça c’est une première des choses. Et après la deuxième. C’est pourquoi par exemple, on s’habitue à aller sur Amazon pour se faire livrer. On s’habitue à être sur des plateformes qui sont loin d’être vertueuses, mais pour autant qui nous rendent bien service. C’est parce qu’elles ont su exploiter les, certaines failles, encore une fois, de nos comportements, en court-circuitant nos efforts. Tu vois, tu remarqueras que la plupart de l’industrie du numérique est une industrie du distanciel. Moins je me déplace moins, je me déplace, plus je fais de choses à distance, mieux je me porte. Et on a parfois du mal à retrouver ce goût de l’effort. L’exemple le plus probant étant ChatGPT, tu vois ? On le donne à tout le monde, on l’utilise tous et ensuite on se dit Ah, est ce que c’est vraiment très bon pour notre cognition ? Est ce que si j’utilise trop j’arriverais encore à écrire un mail tout seul etc. Mais les entreprises de la tech s’en foutent elles. Ce qui compte c’est générer le plus de trafic possible pour générer le plus d’usages possible, qui sont ensuite monnayés à des annonceurs pour faire le plus de profits possible.
– Et pour l’exemple que tu donnais juste avant. Pour être très concret, c’est qu’on ne peut pas emporter sa liste de followers ou d’amis d’une plateforme à une autre. Pourtant, c’est techniquement possible.
– C’est techniquement possible. C’est ce qu’on appelle l’interopérabilité. Pour donner un exemple concret, puisqu’on est sans doute de la même génération ou pas loin, tu te rappelles, à une époque, on avait un numéro de téléphone, le numéro de téléphone était donné par notre opérateur et on ne pouvait pas en changer. C’est-à-dire que tu étais sur SFR avec ton numéro de téléphone, il était assigné à ton opérateur. Donc si tu changeais d’opérateur, tu changeais de numéro de téléphone, ce qui était un peu ennuyeux tu vois, parce que tous tes amis avaient intégré ton numéro de téléphone. Après, il y a une loi qui a obligé finalement à contraindre les opérateurs de dire que vous n’êtes plus propriétaire du numéro. Donc aujourd’hui, tu peux aller chez n’importe quel opérateur avec toujours ton numéro historique. C’est ce qu’on appelle l’interopérabilité. Et donc il n’y a pas d’interopérabilité du côté des réseaux sociaux, c’est pourtant une préconisation qui est en cours lors d’un règlement européen où tu pourrais, par exemple sur X, te dire, je m’en vais ou Instagram, je m’en vais, j’embarque avec moi mes centaines, milliers, dizaines de milliers, peu importe de followers pour aller sur Mastodon, Blue Sky ou des réseaux qui sont plus éthiques. Pour l’instant, c’est pas encore une obligation.
Le rôle essentiel de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI)
– On comprend en t’écoutant, mais aussi en lisant le livre que vous n’êtes ni catastrophistes ni angéliques. Mais vous entendez aussi montrer, avec Virginie Sassoon, qu’avoir les bonnes armes pour faire la paix avec nos écrans est nécessaire, on l’a compris. Mais parmi ces armes, il y a aussi quelque chose dont on n’a pas encore parlé, c’est l’éducation aux médias et à l’information. Elle est centrale. Pourquoi c’est devenu une compétence essentielle pour absolument tout le monde ? Les plus jeunes comme les plus anciens.
– Bah écoute, l’éducation aux médias et l’information, c’est ce qui permet aux utilisateurs que nous sommes d’arriver à comprendre dans quel écosystème on navigue, quels sont justement les pièges et comment arriver à maîtriser un outil qui est finalement plus complexe qu’il n’y paraît. Parce qu’il faut dépasser le simple côté intuitif que les plateformes nous poussent à utiliser pour comprendre, en fait, la manière dont ces outils sont codés, fabriqués, etc. Et surtout, ça devient essentiel parce qu’on ne peut plus rien attendre des GAFAM. On comprend maintenant que et les GAFAM comme Tik Tok, que les grandes plateformes nous font des belles promesses mais qu’elles ne bougent pas. Donc, comme ça ne viendra pas, la solution ne viendra pas des plateformes qui vont devenir d’un coup plus vertueuses. Ça ne peut devenir que du récepteur, donc de nous, pour arriver à discerner encore une fois ce qui est profitable, ce qui est dans notre intérêt et ce qui ne l’est pas. Et donc ça, ça ne passe que par l’éducation aux médias. C’est finalement notre seule arme que l’on a à disposition, comprendre dès le plus jeune âge quels sont les tenants et aboutissants et le fonctionnement d’une économie numérique.
Conclusion : La Fabrique de l’information et les flux numériques
– Comprendre, apprendre. On parlait de médias et de l’information. S’informer sur les médias, c’est important aussi. J’indique que tu proposes de chaque vendredi à quatorze heures sur France Culture, « La Fabrique de l’information ». C’est un rendez-vous radio qui est également disponible en vidéo sur YouTube, dans lequel tu analyses « les grands récits médiatiques et la manière dont l’opinion se façonne ». C’est la promesse, et elle est tenue. C’est une nouvelle émission pour toi depuis la rentrée deux mille vingt-cinq. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En quelques mots, c’est des interviews ?
– C’est des interviews. C’est une émission d’une heure, souvent avec trois ou quatre invités autour d’une thématique, soit qui fait l’actualité, soit qui explique, qui fait de la pédagogie sur le monde médiatique ou le monde des récits. Puisqu’en fait, je sors un peu uniquement du, je sors du champ purement médiatique. Pour moi, ce qui façonne l’opinion, c’est les médias, mais c’est aussi les créateurs de contenus, c’est aussi la publicité, c’est aussi des entreprises. Donc tu vois, c’est comment on arrive à analyser tous ces récits-là, avec une prédominance quand même porté sur le numérique. Parfois, il y a des grands entretiens. J’en ai fait un récemment avec Hugo Décrypte. Donc le créateur de contenu très connu des adolescents qui, pendant une heure, s’est expliqué sur la manière dont il travaillait. Et on essaye d’arriver à donner des clés de compréhension et d’analyse d’un métier : le journalisme, qu’on connaît assez mal. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ce métier et de la manière dont nous sommes tous percutés par quantité de flux. On est vraiment aussi dans une société du flux, et on y participe d’ailleurs tous les deux en créant un flux supplémentaire.
– Oui.
– Mais comment on arrive à comprendre ces flux ? Qu’est ce qui… Comment ils façonnent notre opinion, comment on le reçoit et comment il est conçu. Tu vois la promesse, elle est à peu près des deux côtés, du côté de l’émetteur et du récepteur.
– François Saltiel était dans Soluble(s) ! Chères auditrices et chers auditeurs, j’ai bien conscience qu’on vous propose en effet ce podcast dont l’unique accès a été un écran ou une enceinte connectée. Alors, je vous recommande de vous rendre en librairie pour prolonger votre réflexion et plonger donc dans le livre de Virginie Sassoon et de François Saltiel, et de ne pas trop négliger votre poste de radio, car vous pouvez retrouver François. Je vous donne les horaires. Ce que je n’avais pas fait. « Un monde connecté » chaque matin 8H50 (France Culture) et le vendredi à quatorze heures.
– 14 h !
– On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux j’imagine. Tu es sur tous les écrans ?
– Et oui, j’essaye, j’essaye. J’ai quitté X pour des raisons politiques et de santé mentale, mais je suis sur Instagram et LinkedIn. François, merci d’être passé dans Soluble(s) !
– Merci à toi Simon pour la qualité de ton interview et, à bientôt !
– Avec plaisir ! Voilà, c’est la fin de cet épisode. Si vous l’avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble point media.
À bientôt 😉
POUR ALLER PLUS LOIN
- Lire : « Faire la paix avec nos écrans », Flammarion https://editions.flammarion.com/faire-la-paix-avec-nos-ecrans/9782080476845
Écouter : François Saltiel à la radio sur France Culture ou dans l’application Radio France :
- 8h50 : “Un monde connecté” chaque matin
- “La Fabrique de l’information”, le vendredi à 14h
Et aussi :
- Le site du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI)
- Le Baromètre du Numérique 2025 (Credoc, en PDF)
TIMECODES
00:00 Introduction : Faire la paix avec nos écrans
01:55 Le parcours de François Saltiel : le numérique comme fenêtre sur le monde
03:39 Le smartphone : l’écran amplificateur qui a tout bouleversé
04:49 La réalité des parents : osciller entre « gendarme » et « dealer »
06:23 La « parentalité numérique » : une génération de pionniers
08:29 Sentiment d’impuissance et fin du mythe du « monde virtuel »
11:37 Une clé du dialogue : « Comment s’est passée ta journée en ligne ?
12:46 La méthode P.L.A.Y. (Partager, Libérer, Accueillir, Yes/No)
16:17 La captivité numérique : comprendre le piège des données
18:57 L’interopérabilité : pourquoi on ne peut pas emmener ses abonnés avec soi
20:09 L’éducation aux médias : notre seule véritable arme
22:21 « La Fabrique de l’information » sur France Culture
23:23 Merci à François Saltiel
24:48 Fin
_
Ecouter aussi
Enfants et adolescents : les protéger des écrans. Oui, mais comment ?
Derrière les chiffres du harcèlement scolaire : comprendre et agir
Comment les boîtes aux lettres Papillons libèrent la parole des enfants victimes de violences
Comment naviguer dans le chaos de l’info ? Avec Benoît Raphaël






